Matera n’est pas une ville comme les autres : elle ne résonne pas vers le ciel, mais vers l’intérieur. Sa voix jaillit des parois de tuf qui absorbent la lumière, du souffle lent des Sassi qui gardent l’écho de ceux qui y ont vécu. Chaque son, ici, semble porter la mémoire des siècles. Ce n’est pas un hasard si, dans ce paysage de pierre et de silence, naquit en février 1709 un enfant destiné à changer le destin musical de l’Europe : Egidio Romualdo Duni.
Fils de Francesco, maître de chapelle de la cathédrale, et d’Agata Vacca, il grandit dans une famille où le chant n’était pas ornement mais métier, discipline de l’écoute et manière d’être. On peut imaginer que le petit Egidio, avant de lire la musique, apprit à reconnaître la couleur du silence, la manière dont un son se pose sur la pierre. De là vient sans doute son goût pour une musique claire, essentielle, lucide : une musique qui ne crie pas, mais qui raisonne.
La tradition veut qu’il ait étudié auprès de Francesco Durante dans un conservatoire napolitain, et cela n’a rien d’improbable. À cette époque, Naples était la capitale musicale de l’Europe : un atelier où le contrepoint rencontrait la théâtralité, où la rigueur se tempérait d’ironie. Duni y apprit non seulement la technique, mais une éthique de la composition : écrire signifiait résoudre un problème d’équilibre, non exhiber une émotion. Cette leçon de discipline l’accompagna toute sa vie.
Sa carrière italienne commença tôt et avec succès : Nerone (Rome, 1735) lui apporta la notoriété ; suivirent Adriano in Siria et La tirannide debellata, qui révèlent un sens théâtral inné, une écriture vocale agile, et l’art d’unir l’intensité dramatique à la clarté harmonique. Il se méfiait du baroque des complications : déjà dans ces premières œuvres s’entend la recherche d’une ligne nette, d’une symétrie lumineuse, d’une parole intelligible. Dans un siècle enclin à l’excès, Duni préférait la géométrie.
En 1743, il devint maître de chapelle à Bari, puis à Parme, à la cour des Bourbons, où l’atmosphère cosmopolite le mit en contact avec des musiciens français et allemands. Parme fut son atelier secret : il y apprit la souplesse d’un goût sans frontières, l’art de traduire les idées d’une langue à l’autre, d’unir la sensibilité italienne à la curiosité des Lumières. Le théâtre parisien commençait à regarder vers l’Italie, mais une question demeurait : la langue française pouvait-elle chanter ? Rousseau avait écrit que non, qu’elle était par nature antimusicale. Duni, méridional peu bavard et d’un geste précis, répondit sans polémique, par les faits. Il s’installa à Paris en 1757, et quelques années plus tard fut nommé directeur musical de la Comédie-Italienne.
Ce fut le tournant décisif. Dans une ville où tout aspirait à l’intellect et à l’élégance, Duni apporta un sens méditerranéen du rythme et de la phrase, la spontanéité du discours musical. Il inventa – ou plutôt codifia – la comédie mêlée d’ariettes, la comédie alternant dialogues parlés et morceaux chantés : ce que nous appelons aujourd’hui l’opéra-comique moderne. Son génie ne résidait pas dans la création d’un genre, mais dans la compréhension que l’opéra pouvait respirer comme la vie : que l’air n’était pas une île mais un pont, que le chant pouvait prolonger naturellement la parole. Duni ne théâtralisa pas la musique : il musicalisa la conversation.
Les Français l’appelèrent « papa Duni », titre à la fois ironique et affectueux, qui reconnaissait en lui le maître d’un art nouveau. Ils savaient qu’il était Italien, mais ne le percevaient pas comme étranger. Il avait compris le secret phonétique du français – sa nasalité contenue, sa prosodie syllabique – et en fit une mélodie fondée sur la précision plutôt que sur l’emphase. Dans ses petites ariettes, jamais de virtuosité vaine : tout sert l’action, tout est proportionné à la parole. Il prouva que la clarté n’est pas froideur, que la grâce est une forme de logique, et que l’ironie peut être un acte moral.
L’opéra-comique de Duni n’est pas un théâtre léger : c’est un théâtre moral sous le masque du sourire. Ses personnages ne crient ni ne déclament ; ils parlent en chantant, et le public se reconnaît dans cette naturel. Sous la comédie affleure une philosophie : l’homme comme être qui trouve la vérité dans le quotidien, non dans l’héroïsme. Voilà sa véritable révolution, plus profonde que toute innovation formelle. Dans un siècle épris de sublime, il rendit sa dignité à l’ordinaire.
Il ne fut pas un révolutionnaire au sens moderne : il ne détruisit rien, ne provoqua pas, ne chercha pas la rupture. Il fut un réformateur silencieux, comme seuls les esprits du Sud savent l’être : capables de tout changer sans que l’on s’en aperçoive aussitôt. Sa réforme passa par le détail : l’usage des duos comme moteur de l’action, le raccourcissement des airs pour éviter la redite, le nouveau rôle de l’orchestre, interlocuteur plutôt que décor. Dans chaque mesure se sent la main d’un artisan qui ne veut pas éblouir mais faire fonctionner la machine théâtrale. C’est une leçon de modestie et d’intelligence d’une modernité saisissante.
Avec Duni, la musique italienne émigra en France sans cesser d’être elle-même. Elle y apporta l’art du chant, mais aussi la mesure morale apprise à Naples et, plus en amont encore, la retenue héritée de Matera. Ses origines lucaniennes n’étaient pas un accident géographique : elles étaient une forme mentale. La Lucanie enseigne la patience, la précision, l’art de ne rien gaspiller. Duni transforma ces vertus en esthétique : aucune note superflue, aucune théâtralité déplacée.
Son destin parisien dura près de vingt ans. Il mourut en 1775, quand Mozart était encore adolescent et que Gluck avait déjà ouvert la voie du drame classique. Pourtant, sans Duni, aucun de ces deux mondes n’aurait été le même. Gluck porta la tragédie à son accomplissement ; Mozart réalisa la synthèse du comique et du dramatique ; Duni, lui, avait préparé le terrain : il avait montré que la légèreté pouvait contenir la profondeur, que l’ironie pouvait être une mesure.
En homme du Sud, il concevait la « réforme » de manière concrète : moins de proclamations, plus de faits. Là où Gluck écrivait des manifestes, Duni écrivait des ariettes ; là où Rousseau disputait, Duni composait. C’est la différence entre ceux qui parlent du monde et ceux qui le font fonctionner.
Son parcours illustre magnifiquement comment l’Italie méridionale sut être européenne bien avant d’être une nation : Duni à Paris, Jommelli à Stuttgart, Piccinni bientôt à Paris, Paisiello à Saint-Pétersbourg – tous issus du même sol napolitain, tous capables de se faire entendre ailleurs sans trahir leur langue. Mais aucun n’incarna cet équilibre plus pleinement que Duni : il porta l’Italie en France sans cesser d’être lucanien.
Un autre lien, presque symbolique, rattache son histoire à ma propre terre. Pomarico, le village d’où vient ma famille maternelle, est le même où naquit le grand-père d’Antonio Vivaldi. On pourrait dire qu’entre Pomarico et Matera coule une rivière souterraine de musique, une vocation qui traverse les siècles et les frontières. Vivaldi et Duni : deux destins opposés et complémentaires. Le premier, le feu de Venise – la vertige de la couleur, la rapidité du geste ; le second, la raison calme du Sud – la pudeur de la forme, le goût de la mesure. Deux manières d’exprimer la même idée : la musique ne naît pas du hasard, mais d’un lieu de l’âme.
Aujourd’hui, deux siècles et demi après sa mort, Matera célèbre Duni par le Festival qui porte son nom, arrivé à sa vingt-sixième édition. Ce n’est pas une commémoration formelle, mais un retour affectif. Chaque automne, entre les églises rupestres et les palais baroques, cette musique que le temps avait endormie renaît, et la ville entière semble respirer avec elle. Le thème de cette année – Patrimoni Sonori, « Patrimoines sonores » – exprime parfaitement le sens de ce rite : la conscience que le patrimoine n’est pas un dépôt, mais un geste à renouveler. Ramener Duni à Matera, c’est lui rendre la patrie qu’il n’avait jamais perdue.
Écouter à nouveau ses œuvres – Le peintre amoureux de son modèle, La fée Urgèle, L’école de la jeunesse – revient à contempler un dessin architectural après des siècles de peinture exubérante : soudain, tout devient lisible. Dans son écriture, on respire la sobriété d’un homme qui connaissait le poids du temps. Ses mélodies ne cherchent pas l’effet, mais la continuité. L’orchestre est limpide, jamais redondant ; la voix dialogue, elle ne domine pas. C’est une musique faite pour durer plutôt que pour briller – et elle dure en effet.
Dans l’Italie d’aujourd’hui, qui oublie trop souvent ses maîtres du XVIIIᵉ siècle, Duni demeure un modèle de modernité civique. Sa leçon ne concerne pas seulement la musique, mais la manière d’être au monde : travailler avec rigueur, parler avec mesure, unir l’artisanat à la curiosité intellectuelle. C’est l’éthique du métier contre la rhétorique du génie, la sobriété contre la frénésie de l’apparence.
En ce sens, sa figure parle encore à ceux qui écrivent et écoutent aujourd’hui, dans un temps de communication frénétique et de mémoire brève. Duni nous rappelle que la culture ne naît pas du bruit, mais du silence préparé ; que la beauté n’est pas urgence, mais construction ; que la musique, pour être universelle, doit d’abord rester fidèle à son origine. Son origine était Matera – et de Matera il partit, comme tous ceux qui ont quelque chose à dire, pour revenir un jour d’une autre direction.
Lorsque, les soirs d’automne, le Festival Duni allume ses concerts et que la pierre de la ville devient caisse de résonance, on n’entend pas seulement les notes d’un compositeur, mais la voix d’une terre entière se reconnaissant enfin en celui qui l’a rendue grande. Peut-être le véritable héritage de Duni n’est-il pas seulement la naissance de l’opéra-comique, mais la certitude que même depuis les marges du monde peut surgir une forme d’universalité.
Et si Matera incarne la solidité du temps, Pomarico en garde la généalogie. C’est là qu’est né le grand-père de Vivaldi, et là subsiste le secret d’une Italie qui sut se faire entendre sans fracas. Triangle de pierre et de son : Pomarico, Matera, Paris. Entre ces coordonnées se déploie l’histoire d’Egidio Romualdo Duni, et aussi une part de nous-mêmes : cette culture méridienne qui unit la mesure à la lumière, la logique au sentiment, la rigueur à la tendresse.
Aujourd’hui, dans une Europe qui semble avoir oublié ses racines méditerranéennes, se souvenir de Duni revient à rappeler que la vraie modernité naît de la mesure, non de l’excès. C’est le geste d’un homme parti d’une petite ville du Sud pour enseigner au monde qu’on peut être universel tout en restant fidèle à sa langue. En ce sens, sa leçon n’est pas achevée : c’est une invitation à la discrétion, à l’intelligence, à une beauté qui n’a pas besoin d’élever la voix pour être entendue.
Et ainsi, deux cent cinquante ans plus tard, Egidio Romualdo Duni parle encore – non plus depuis les scènes de Paris, mais depuis les pierres de Matera, qui lui répondent comme un chœur secret. Sa musique n’est pas un monument, mais un souffle : celui d’une terre qui continue de chanter à travers ceux qui, comme lui, ont su transformer le silence en mesure et la mesure en liberté.
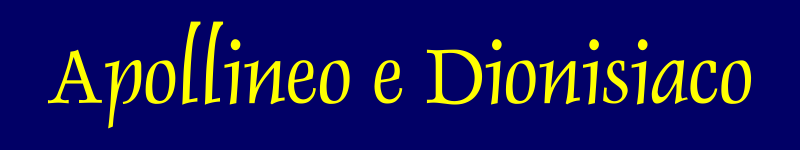
![]()