Il existe des livres qui ne cherchent pas à « tout dire », mais à mettre de l’ordre. Brevi lezioni di storia italiana (e non solo) appartient à cette catégorie rare : un ouvrage qui choisit la soustraction comme méthode et la clarté comme forme, confiant à deux voix autorisées — Ernesto Galli della Loggia et Paolo Mieli — la tâche de ramener plus de deux siècles d’histoire à une ligne intelligible, sans réduction et sans emphase.
La méthode est annoncée dès le début : saisir un long siècle de fractures — guerres, totalitarismes, démocraties fragiles, crises économiques, renaissances — et en distiller les liens, les causes, les répétitions profondes. Les auteurs travaillent de manière complémentaire : Mieli avec l’intelligence narrative du divulgateur civique, Galli della Loggia avec le regard ample de l’historien qui interroge les fondements. Le résultat n’est pas une simplification, mais une œuvre qui rend lisible. Et aujourd’hui, ce n’est pas rien.
L’ouvrage traverse le Risorgimento, l’âge libéral, la Grande Guerre, les tragédies totalitaires, la Guerre froide, les transformations de la République et la mondialisation. Mais ce n’est pas une succession de chapitres scolaires : c’est plutôt un atlas de points nodaux, une géographie essentielle qui restitue l’unification italienne dans son équilibre précaire, la fragilité de l’État libéral, la brutalité des idéologies du XXᵉ siècle et les formes — plus douces, mais tout aussi pénétrantes — du pouvoir contemporain.
L’un des mérites les plus fins du livre réside précisément dans sa capacité à éclairer des points de vue inattendus.
Dans le récit de l’âge libéral, par exemple, les auteurs parviennent — en une seule page limpide — à évoquer le sens d’une modernisation inachevée sans tomber dans les lieux communs.
De même, dans l’analyse du rapport entre totalitarismes et masses, ils offrent un passage d’une rare efficacité montrant comment la propagande fonctionne moins comme « imposition » que comme offre d’appartenance : un détail qui vaut, à lui seul, davantage que bien des manuels.
Autre élément fort : l’équilibre entre Italie et Europe. Dans la narration de la Grande Guerre, dans l’analyse de la fragilité des démocraties de l’entre-deux-guerres, dans la lecture de la République italienne et de ses tensions dans les années 1970 et 1980, tout s’inscrit dans un contexte plus large, non provincial, profondément historique.
Le livre ne prétend pas être définitif ; il cherche plutôt à être utile.
Et il l’est.
Parce qu’il restitue une histoire de l’Italie qui évite à la fois la nostalgie et la condamnation moralisatrice, offrant au lecteur un fil, une boussole, une grammaire minimale pour s’orienter dans le passé et — inévitablement — dans le présent.
C’est un volume que l’on peut lire en quelques heures, mais qui demeure en mémoire par la netteté de son ton et le sérieux de son regard.
Une synthèse brève, oui, mais loin d’être « minimale ».
Solferino accompagne ce travail avec une édition claire et soignée, pensée pour un large public et fidèle à la ligne désormais reconnaissable de l’éditeur : une écriture historique rigoureuse et accessible. Il ne serait pas surprenant d’en voir circuler des extraits longtemps dans les écoles et les cours universitaires d’introduction : c’est un livre qui fonctionne comme un pont, non comme une conclusion.
Dans une Italie qui peine souvent à lire son passé sans idéologie, cet ouvrage offre une invitation discrète mais ferme :
regarder l’histoire non pour justifier, mais pour comprendre.
Et pour comprendre véritablement, il faut parfois exactement ce que ce livre offre : l’art noble de la clarté.
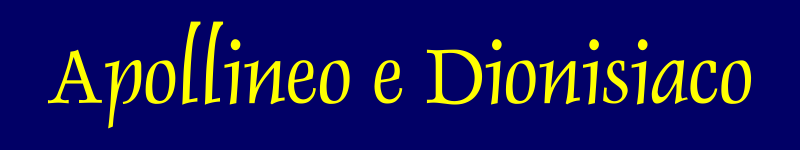
![]()