Il n’arrive pas souvent que l’on s’assoie au Costanzi en sachant que l’on va assister à quelque chose qui n’y était plus arrivé depuis un demi-siècle. La deuxième représentation de Lohengrin commence dans un climat étonnamment calme : aucune atmosphère d’événement fabriqué, aucune excitation de « première », mais plutôt l’impression de rentrer dans une pièce que le théâtre avait gardée fermée beaucoup trop longtemps.
J’ai choisi d’être présent à la deuxième, comme je le fais chaque fois que je le peux, parce que la première est l’instantané de la soirée d’ouverture et la deuxième est le moment où le spectacle se laisse observer avec plus d’honnêteté. Ce que j’ai trouvé n’est pas le retour triomphal d’un titre absent, mais le mouvement patient d’une machine théâtrale qui prend Lohengrin au sérieux comme histoire de personnes avant d’être une histoire de symboles : une communauté fragile, une femme qui vacille, un homme qui arrive pour sauver et finit par rouvrir des blessures.
La production choisit la voie de la cohérence interne et d’un dialogue étroit entre la scène et la fosse. Au pupitre, Michele Mariotti, pour sa première confrontation avec Wagner, construit un discours sonore d’une grande clarté ; sur scène, Damiano Michieletto, avec Mattia Palma à la dramaturgie, Paolo Fantin aux décors, Carla Teti aux costumes et Alessandro Carletti aux lumières, dessine une lecture compacte, reconnaissable, qui ne se laisse pas séduire par le folklore chevaleresque et préfère interroger ce que Lohengrin raconte aujourd’hui : le besoin de s’en remettre à quelqu’un et la crainte, presque immédiate, de cet abandon même. C’est une lecture forte, qui range la classicité dans un tiroir et, à sa place, met sous les yeux du spectateur une série de questions qui laissent transparaître l’inquiétude de notre temps.
Le cœur du travail de Michieletto est le regard porté sur la communauté. Le peuple de Brabant devient une assemblée compacte, presque un chœur grec de province : il regarde, juge, resserre les personnages dans un cercle qui s’élargit et se referme, les met littéralement au centre. L’histoire ressemble à un procès qui ne finit jamais : plus que la rédemption, ce qui domine est le mélange de culpabilité, de suspicion et de besoin de croire. Le mystère de l’identité de Lohengrin n’est qu’un des nœuds d’un conflit plus large entre désir de foi et peur de l’inconnu.
Fantin traduit tout cela dans un grand espace unique et courbe, non pas inquiétant mais même lumineux : une structure de bois qui évoque à la fois salle de tribunal, enclos, ventre. Au premier acte, le bois jaunâtre est une coque fermée, chaude et oppressante : il encadre les groupes, délimite les parcours, crée naturellement des lieux d’isolement et de siège. Au deuxième acte, la scène se concentre autour d’un grand œuf sombre, signe d’origine et d’ambivalence : il est à la fois berceau et menace, promesse et danger. Au troisième acte, lorsque la question interdite est enfin prononcée, la matière se transforme : l’argent envahit l’espace, l’œuf s’ouvre, les surfaces deviennent réfléchissantes, glissantes, presque impossibles à saisir. Le jeu entre bois et métal n’est pas un simple effet visuel : le bois appartient à la dimension humaine, poreuse, finie ; les surfaces argentées, froides et fluides, renvoient à un autre domaine, proche du monde de Lohengrin, qui attire et repousse à la fois.
L’élément de l’œuf apparaît comme un signe fort, mais non comme une allégorie martelée : c’est un objet qui habite la scène et concentre les regards plus qu’une clé d’interprétation imposée. Bien plus déterminante, à l’épreuve du plateau, est la manière dont cet espace contraint les corps : il suffit de regarder Elsa lorsque la communauté se referme autour d’elle, ou Telramund qui glisse aux marges de cette coque, pour comprendre où la mise en scène veut porter le regard.
Le célèbre motif du cygne est volontairement désamorcé sur le plan illustratif. Il n’y a aucun grand animal scénique pour capter le regard : l’image survit comme trace, comme détail, comme signe à déchiffrer, tandis que la mise en scène insiste sur les conséquences concrètes de son apparition et de sa disparition dans les corps des personnages et dans leurs rapports de force. La direction d’acteurs est soignée avec précision : Elsa est constamment placée au centre d’un système de vecteurs opposés – désir de s’abandonner à une promesse de salut, exigence de comprendre et de nommer ce qui lui arrive ; Lohengrin n’est pas un héros monolithique, mais un homme qui porte sur lui le poids de son propre statut ; Ortrud agit comme une stratège du doute, lucide et insinuante ; Telramund est une figure marquée, mû par les ressentiments et les frustrations plus que par un simple instinct de domination.
Les costumes de Carla Teti scellent cette suspension temporelle : nous ne sommes ni dans un Moyen Âge de livre d’images, ni dans un contemporain strictement naturaliste. Les lignes sont essentielles, avec des accents qui suggèrent des réminiscences du XXᵉ siècle et des allusions politiques sans se transformer en illustration didactique. Les lumières d’Alessandro Carletti jouent sur l’alternance de coupes nettes et de zones d’ombre, d’aveuglements soudains et de demi-teintes de chambre intérieure : elles éclairent et effacent, révèlent et blessent, contribuant de manière déterminante à la perception d’un monde qui, peu à peu, devient de moins en moins stable.
Sur le plan musical, Mariotti propose un Lohengrin d’une grande transparence. Sa lecture évite toute tentation monumentale et construit un Wagner limpide, tendu, ciselé avec soin dans ses rapports internes. La direction ne se livre jamais à des excès de volume, elle préfère le détail à la masse et la ligne au simple impact. L’orchestre répond avec précision, dans un jeu de plans sonores net et un équilibre constant entre cordes et vents. Ce qui surprend, c’est la naturalité avec laquelle Mariotti aborde un titre qui exige un sens du souffle dramatique loin d’être évident : son interprétation conserve une limpidité orchestrale presque cristalline dans les points névralgiques, avec une raréfaction des plans sonores qui permet à la structure wagnérienne d’émerger avec une clarté rare.
Ce n’est pas une transparence faible, ni un allègement esthétique : c’est un travail de ciselure, de lucidité constante, qui rend à la partition un équilibre interne souvent sacrifié ailleurs. À plus d’un moment, cette clarté se révèle plus convaincante que des exécutions récentes entendues dans des théâtres bien plus liés, par tradition, au répertoire wagnérien. Il y a une maturité non ostentatoire, une sûreté dépourvue de complaisance, qui place cette lecture à un niveau élevé, vraiment élevé. Mariotti a travaillé sur la clarté narrative sans perdre la tension interne de la partition, et il accompagne les voix sans les couvrir ni les laisser à découvert.
L’orchestre du Teatro dell’Opera, disions-nous, répond avec une compacité qui ne s’alourdit jamais : les cordes gardent un profil souple mais non flou, les bois émergent dans toute leur fonction narrative, les cuivres sont présents et contrôlés, sans débordements tonitruants. L’attention au souffle théâtral est constante : les tempi ont une tension de base qui évite la stase, mais restent élastiquement ancrés aux exigences de la parole chantée et aux temps de la scène. Le dessin d’ensemble apparaît finalement lumineux, stratifié sans être opaque : un Wagner où l’entrelacs des voix internes est perceptible, où les leitmotivs émergent comme des lignes de force naturelles plutôt que comme des signes superposés.
Le Chœur du Teatro dell’Opera, préparé par Ciro Visco, est l’un des principaux instruments de ce spectacle. Géré avec une grande souplesse dynamique, il passe de masses compactes de son à des filigranes plus délicates sans perdre la précision de l’intonation ni la cohésion de l’attaque. Dans une production qui fait de la communauté un personnage décisif, ce niveau d’exécution devient essentiel : aussi bien dans les grands blocs cérémoniels que dans les moments où la foule se fait presque murmure, le chœur soutient et amplifie les choix de mise en scène.
Dans le rôle-titre, Dmitry Korchak dessine un Lohengrin lyrique et concentré, loin du modèle exclusivement « héroïque ». Sa ligne profite de son expérience belcantiste : attention constante à l’arc de la phrase, soin de la dynamique, intelligence dans le rapport avec l’orchestre. La figure qui en résulte est celle d’un chevalier moins granitique, plus enclin à la fragilité, en accord avec une idée du personnage qui ne domine pas simplement les événements, mais s’en trouve par moments emporté.
Jennifer Holloway offre une Elsa d’une grande cohérence interne. Son timbre clair, la tenue du legato et le contrôle des demi-teintes lui permettent de parcourir le chemin du personnage sans fausses notes stylistiques : du récit initial du rêve jusqu’au duo du troisième acte, on perçoit un dessin réfléchi, où la fissure progressive de la confiance se reflète dans la couleur et dans l’accent, et pas seulement dans le geste. L’intégration avec la mise en scène – surtout dans les longs moments où Elsa est littéralement encerclée et observée par la communauté – est l’un des points forts du spectacle.
Ekaterina Gubanova est une Ortrud de grand impact. L’ampleur du registre central, la projection sûre, la maîtrise des nuances dynamiques lui permettent de modeler le rôle avec liberté sans jamais perdre en définition. Les invocations païennes ont une force presque rituelle, mais toujours contrôlée ; les dialogues avec Telramund sont sculptés avec une précision qui rend perceptible la nature manipulatrice du personnage. Au deuxième acte, sa présence infléchit la perception générale de la scène : chaque geste et chaque regard contribuent à faire monter le niveau de tension.
Tómas Tómasson, en Telramund, allie solidité vocale et forte présence scénique. Le personnage acquiert une dimension presque tragique : non pas simple antagoniste de service, mais homme marqué que l’on voit entraîné, avec Ortrud, dans une spirale de ressentiment et de défaite. Sa capacité à modeler la parole, à faire ressortir les différentes nuances du texte, rend ce parcours crédible.
Clive Bayley prête au roi Henri une autorité naturelle, faite de mesure et de contrôle plus que d’emphase. La voix conserve un noyau de noblesse timbrique qui s’accorde bien avec le trait de mise en scène : souverain qui entre et sort d’un monde qu’il ne parvient pas vraiment à réparer, garant d’un ordre plus évoqué que véritablement praticable.
Andrei Bondarenko, en Héraut, signe une intervention exemplaire par sa clarté et sa musicalité : chacune de ses apparitions est nette, bien posée sur le souffle, avec une diction qui rend immédiatement compréhensible le rôle de « voix du pouvoir » que lui confie la partition. Il en résulte un personnage mineur seulement sur le papier, mais décisif dans l’équilibre des forces dramatiques.
Les jeunes de la « Fabbrica » – Alejo Álvarez Castillo, Dayu Xu, Guangwei Yao, Jiacheng Fan dans les rôles des nobles, et Mariko Iizuka, Cristina Tarantino, Silvia Pasini, Caterina D’Angelo dans ceux des pages – s’insèrent avec une grande naturelle dans le tissu de la soirée. Les voix sont homogènes, musicales, déjà bien orientées stylistiquement ; la mise en scène les utilise avec intelligence, en valorisant leur fraîcheur scénique.
La réaction de la salle est chaleureuse et prolongée : les applaudissements insistent sur l’orchestre, le chœur et les protagonistes, mais embrassent toute l’équipe créatrice. Plus que l’effet d’un spectacle à thèse, demeure la sensation d’un travail d’ensemble solide, dans lequel chaque secteur est appelé à soutenir une idée claire : mettre au centre non pas l’icône du chevalier miraculeux, mais la communauté qui oscille entre le besoin de s’en remettre et la fureur d’interroger. En ce sens, le Lohengrin romain marque une étape importante dans la relation entre le Costanzi et Wagner, et laisse au théâtre une production réfléchie, reconnaissable, parfaitement capable de tenir le plateau pendant encore plusieurs saisons. Car Lohengrin ne peut pas rester silencieux pendant cinquante ans de plus : il doit revenir plus souvent au Costanzi, avec le niveau de qualité que nous avons entendu cette fois-ci.
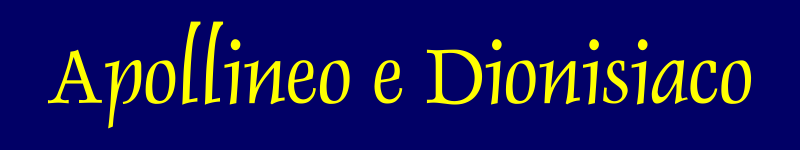
![]()