Il existe des œuvres qui ne faiblissent pas aujourd’hui par faiblesse intrinsèque, mais parce que notre écoute contemporaine a perdu la patience des formes dramatiques qui n’offrent aucune gratification immédiate. Cesare in Egitto de Geminiano Giacomelli, ressuscité par Alpha Classics sous la direction d’Ottavio Dantone, appartient à ce répertoire qui ne demande pas d’être aimé : il exige d’être compris.
Il n’offre aucun raccourci, ne concède aucune séduction, n’éclaire rien avec la facilité de ceux qui recherchent l’applaudissement. Il demande plutôt une écoute capable de reconnaître qu’en 1735, le théâtre n’était pas encore psychologie, mais responsabilité.
Giacomelli se situe à un moment décisif de l’histoire musicale italienne : le dernier feu du pré-métastasien, lorsque la rhétorique des affects n’était plus l’exubérance monteverdienne ni la géométrie parfaite de l’opéra réformé. Son langage semble retenu par une force intérieure qui préfère l’insistance à la variété, le poids à l’expansion, la décision à l’émotion.
Une musique qui ne cherche pas à séduire, mais à contenir, comme une berge affrontant la force du fleuve.
Son César n’est pas celui que nos habitudes théâtrales connaissent le mieux. Ici, le protagoniste n’est pas la séduction du pouvoir, mais sa solitude. On ne trouve pas la brillance du chef qui conquiert et charme : on trouve l’homme qui porte son rôle comme une cuirasse inévitable.
C’est un César sans exhibition, mais dense, concentré, vigilant : un personnage qui ne s’explique pas, mais qui s’impose.
L’aria la plus célèbre, Col vincitor mio brando, est souvent réduite — par paresse — à une page de virtuosité martiale. En réalité, c’est un autoportrait dramatique : non un triomphe, mais une confession. La colorature ne scintille pas ; elle pèse. La tessiture n’exalte pas ; elle alourdit. Le souffle ne court pas ; il résiste.
Ici, la victoire n’est pas une gloire : c’est un fardeau exposé par la voix sans rhétorique, révélant une tension morale plutôt qu’un triomphe militaire.
L’épée ne brille pas : elle pend.
Dans ce cadre, le choix des interprètes assume un rôle dramaturgique décisif. Et le nouvel enregistrement Alpha trouve une cohérence rare, car chaque voix agit non comme une individualité isolée, mais comme une partie d’un organisme scénique.
Le César d’Arianna Vendittelli mérite une mention particulière. Non seulement pour sa solidité technique, la précision du geste vocal ou la maîtrise naturelle de l’agilité : ce qui importe, c’est l’idée dramaturgique qui la soutient. La ligne ne se contente pas de porter le personnage : elle le crée. L’émission, toujours surveillée, semble définir un code moral plutôt qu’une dynamique théâtrale. Vendittelli ne cherche pas à agrandir César : elle le concentre.
Le résultat est un portrait d’une noblesse sèche, presque implacable, où le pouvoir n’est jamais exhibé mais porté — comme un poids ancien — avec une lucidité qui n’appartient qu’aux interprètes les plus conscients.
La Cléopâtre d’Emöke Baráth est une figure d’une rare intelligence musicale. Elle ne s’abandonne pas à la séduction comme geste extérieur ; elle la transforme en stratégie. Le phrasé est un tissu continu, souple mais vigilant, capable de passer d’une luminosité d’émail à une concentration intérieure presque méditative. Chaque legato semble précédé d’une pensée ; chaque ornement est un acte d’interprétation, non une concession à la grâce.
La Cornelia de Margherita Maria Sala apporte au drame une gravité qui ne sombre jamais dans la lamentation. La qualité du timbre, sombre et transparent à la fois, donne au chagrin une forme verticale, composée, qui ne demande pas l’empathie mais le respect. Sa présence scénique — même à travers le micro — maintient intacte une noblesse que le personnage reçoit rarement dans les exécutions modernes.
Le Tolomeo de Valerio Contaldo est construit avec une lucidité tranchante. La voix ne tombe jamais dans la caricature, n’indulge jamais dans un venin facile : elle tranche. Dans les récitatifs, la parole a une précision chirurgicale ; dans les airs, Contaldo dose la tension avec intelligence, évitant le grotesque et recherchant une froideur contrôlée qui rend le personnage étonnamment moderne.
L’Achilla de Filippo Mineccia trouve la mesure entre force et retenue. La voix possède une consistance qui ne devient jamais opaque ; son ambition est rendue par une tension intérieure, non par l’enflure du geste. Cet Achilla n’explose pas : il presse. Et cette pression donne au rôle une profondeur inattendue.
Le Lépido de Federico Fiorio, rôle mineur mais non secondaire, offre cette touche de clarté rhétorique qui tient ensemble les fils narratifs les plus subtils. Fiorio chante avec élégance et précision, rendant au personnage une dignité souvent négligée.
Par-dessus tout, la direction d’Ottavio Dantone jette une ombre longue et nécessaire. Aucun geste ne cherche la surface ; aucun tempo n’est choisi pour séduire ; aucune palette n’est exhibée comme virtuosité orchestrale. Sa lecture incise plutôt qu’elle ne peint.
Les tempi avancent avec une logique intérieure ferme, presque inexorable ; les dynamiques respirent comme partie du drame et non comme décoration ; l’Accademia Bizantina sculpte chaque ligne avec une attention extrême, refusant toute douceur ornementale.
Il n’y a ici aucun fétichisme philologique : il y a une conscience historique.
Aucun pittoresque baroque : mais un ordre dramatique.
Et c’est précisément ce choix qui restitue à Cesare une vitalité que des lectures plus hédonistes peuvent difficilement soutenir.
Alpha Classics accomplit un geste éditorial non ornemental mais historiographique : placer ce titre aux côtés des grandes redécouvertes de ces dernières années, non comme curiosité, mais comme pièce manquante du mosaïque musical italien du XVIIIᵉ siècle.
Ce n’est pas une résurrection : c’est une restitution.
Ainsi, ce Cesare apparaît pour ce qu’il a toujours été : un drame qui n’accorde aucune variété facile, un théâtre qui ne distribue pas d’émotions à bas prix, une machine scénique qui ne brille pas — elle brûle.
L’œuvre ne cherche pas à être aimée. Elle demande à être respectée.
Et cet enregistrement lui rend non seulement une voix, mais un visage, une posture, un destin.
À une époque qui consume tout avec une rapidité féroce, une œuvre qui refuse l’immédiateté devient presque un acte de résistance.
Un théâtre qui ne flatte pas le public, mais le force à grandir.
Ce Cesare ne demande pas l’amour : il demande l’écoute.
Et dans cette écoute, si sévère et si rare, il retrouve sa nécessité.
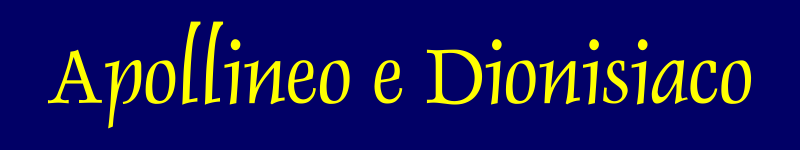
![]()