Au Japon, il existe des métiers qui, ailleurs, sembleraient sortis d’un récit de science-fiction : petites amies à louer, parents provisoires, personnes payées pour écouter, marcher à vos côtés, offrir simplement leur présence. Ce ne sont pas des curiosités folkloriques : ce sont des réponses pragmatiques à une forme de solitude urbaine que le pays nomme avec la même simplicité que l’on commande un thé. C’est dans cet horizon — où les relations se définissent non par l’intensité mais par le service, la durée et la discrétion — que Laura Imai Messina place son invention la plus subtile : une femme qui accompagne des inconnus sous un parapluie. Un petit morceau de route, rien de plus. Et pourtant, c’est là, dans ce geste minimal, que le roman trouve sa force.
Ce n’est pas un artifice narratif. Messina n’a pas besoin de surprendre : elle a besoin d’observer. Le livre ne ressemble pas à un roman au sens habituel — avec son intrigue, sa progression, ses retournements — mais à un climat, à un système météorologique où les émotions prennent forme comme tombe l’eau : par densité, par rythme, par inclinaison. Les mots japonais qui nomment les différentes pluies ne sont pas un exercice de style : ils sont le vocabulaire émotionnel d’une protagoniste qui enregistre le monde en degrés d’humidité et de résistance, comme si l’eau était la véritable langue maternelle à partir de laquelle elle traduit lentement sa propre existence.
Le point de départ — une femme qui prête son parapluie contre rémunération — pourrait sembler appartenir à un anime romantique, mais Messina le traite avec une conscience littéraire bien supérieure à l’entertainment. En Occident, une idée semblable renvoie immédiatement à Rent a Girlfriend, le manga de Reiji Miyajima, qui a transformé le « rental affectif » en une machine narrative faite de malentendus, d’accélérations, de cliffhangers et de triangulations émotionnelles. Messina fait l’inverse : elle part de la même infrastructure sociale — un service destiné à combler temporairement un manque — et la distille en quelque chose d’à peine mobile, de suspendu, de délicatement asymétrique. Là où Miyajima construit la tension, elle construit le silence. Là où le manga multiplie les événements, elle les soustrait jusqu’à n’en laisser que l’empreinte.
Sa Tokyo n’est pas celle des gratte-ciel scintillants, des quartiers vibrants, des foules qui submergent. C’est une ville parcourue précisément là où la pluie modifie l’allure : passages étroits, rampes qui obligent à ralentir, lumières des konbini qui tremblent sur les flaques. Des lieux où deux personnes peuvent marcher côte à côte sous le même parapluie et rester séparées de quelques centimètres — des centimètres qui comptent plus que tout. Le roman vit dans ces marges, dans la partie basse de la ville, où la vie ne hausse jamais la voix.
Il y a des pages qui possèdent la délicatesse de Kore-eda, cette capacité à révéler la dignité des vies minuscules sans les forcer dans un arc narratif ; des dialogues qui semblent presque marcher lentement, comme dans les meilleurs moments de Hamaguchi ; des intérieurs où la lumière et l’eau deviennent une seule matière, comme chez Kawase. Et en filigrane, un sentiment de proximité retenue que, en Occident, nous associons immédiatement à Wong Kar-wai — non par imitation, mais par affinité de regard. Messina sait que l’émotion la plus forte n’est jamais celle qui explose : c’est celle qui reste en suspens lorsque deux personnes se frôlent et ne savent pas si c’est la peur ou le désir qui les immobilise.
Et puis il y a la pluie : personnage silencieux et omniprésent. On la sent dans l’air comme dans les films de Makoto Shinkai, où l’eau n’est pas un simple décor mais une condition, une limite, une promesse. La « métrique » de la pluie chez Shinkai — cette manière dont la lumière se fracture, dont le son se modifie — trouve dans le roman une traduction littéraire étonnamment fidèle à l’effet émotionnel plutôt qu’à l’effet visuel. Messina n’utilise pas la pluie comme symbole poétique : elle l’utilise comme point de vue. C’est la pluie qui décide quand s’approcher, quand attendre, quand ne pas risquer.
La protagoniste, Aya, n’est jamais définie par un passé raconté de manière linéaire, ni par une psychologie exposée comme un diagnostic. C’est un personnage qui existe surtout par soustraction. Le lecteur la connaît par la manière dont elle regarde le monde, par les détails qu’elle choisit de noter, par la distance qu’elle garde — et qu’elle peine à garder — lorsqu’elle marche aux côtés des autres. Les clients qu’elle accompagne sont des figures qui effleurent la page et disparaissent : un chœur de présences légères capables de modifier une inflexion du texte sans réclamer de scène.
Le roman avance comme une série de « tableaux atmosphériques » : chaque chapitre est une variation sur le thème de l’eau et du contact humain. C’est une structure peu commune dans la fiction italienne, et peut-être pour cela fascinante : l’histoire ne va pas de A à B, ne construit pas, ne prépare pas, n’explose pas. Elle advient. Comme advient une averse. Comme advient une rencontre. Comme advient cette forme d’intimité qui n’a pas besoin de se manifester pour exister.
Messina ne propose pas de solutions, n’offre pas de diagnostics, n’amène rien à son terme. Elle ne promet pas de catharsis. Elle promet des vérités minimales. Et elle révèle simplement que certaines histoires poussent comme une forêt : lentes, stratifiées, accidentelles, capables de surgir soudain après des années où elles semblaient avoir disparu.
Les illustrations d’Emiliano Ponzi, disséminées dans le volume, forment un contrechant parfait. Elles ne racontent pas, n’interprètent pas, ne « décorent » pas. Elles amplifient. Ce sont des surfaces où la lumière cède à la pluie, où la ville se resserre dans un cadrage qui pourrait évoquer Shinkai sans cette austérité chromatique, profondément occidentale. Leur fonction n’est pas descriptive mais atmosphérique : elles éclaircissent le climat émotionnel, non la scène.
Mais la véritable force du roman ne réside ni dans l’idée ni dans le décor : elle réside dans la manière dont Messina raconte la distance. Certains livres parlent d’amour ; celui-ci parle de cet espace qui précède l’amour, le suit, ou s’y substitue. L’espace où l’on marche sans rien attendre, où deux personnes peuvent partager quelques pas et comprendre — sans le dire — que tout lien n’a pas besoin de “devenir” quelque chose pour être réel. Le soin n’est pas un geste spectaculaire : c’est l’ombre que quelqu’un tient au-dessus de vous pendant qu’il pleut, sans rien demander en retour.
Messina ne résout rien, ne conclut rien. Elle n’offre aucune rédemption. Elle offre une manière de voir. Le parole della pioggia est un livre qui ne demande pas au lecteur de dévotion, mais de présence. Il suffit de se tenir dessous, comme sous un parapluie prêté par quelqu’un que l’on ne connaît pas. Le bout de chemin est bref ; la sensation, elle, demeure.
Ce n’est ni un roman sur l’amour, ni un roman sur son absence : c’est un roman sur cette forme fragile de proximité qui n’a pas de nom, n’exige aucun avenir, et n’a pas besoin d’évoluer pour être vraie. Une relation provisoire, comme un parapluie emprunté sous la pluie.
Un parapluie loué, donc.
Qui révèle plus qu’il ne protège.
Et cela suffit — vraiment — pour en faire un roman important.
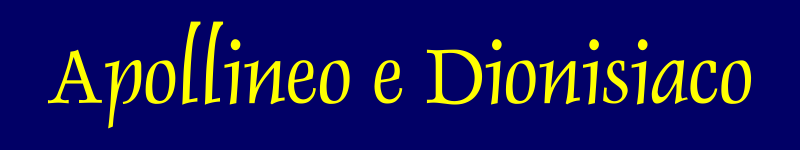
![]()